Thrombose
et Cancer
Rôle de l’IDEL et
Sensibilisation à destination des patients :
Thrombose et Cancer :
Le rôle majeur de l’infirmier(ère) dans l’adhésion du patient au traitement et dans son parcours de soins pluridisciplinaire
Rafik Belhadj: Médecin Vasculaire CHU Poitiers;
Aurelie Ferru: Oncologue CHU Poitiers;
Isabelle Varlet: Infirmière Présidente URPS infirmier(ère) Nouvelle Aquitaine
En France, on estime à 400 000 le nombre de nouveaux cas de cancers (incidence) et à 150 000 le nombre de décès (mortalité) en 2017. 20 % des patients développeront une maladie thrombo-embolique veineuse au cours de la maladie.

C’est donc un problème de santé publique nécessitant la coordination de tous les acteurs dont l’infirmier(ère) qui est en contact chaque jour avec les patients
Raison pour laquelle l’URPS des infirmiers(ères) a participé dès le début 2014 au projet prise en charge de la thrombose chez le patient atteint de cancer en Poitou Charentes avec l’ensemble des acteurs institutionnels (ARS, URPS, OMEDIT, CHU, RRC ) Ce travail fera l’objet d’une publication en mai 2018. Ce programme est en train de se déployer sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
Le patient atteint de cancer présente un risque majoré de développer une maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV). L’incidence est de 15 % et varie en fonction du stade du cancer, du type du cancer et des traitements anticancéreux.
La MTEV est un facteur de mauvais pronostic représentant la seconde cause de décès chez les patients atteints de cancer : une prise en charge optimale est indispensable.
Le traitement de la MTEV chez le patient atteint de cancer est spécifique. C’est pourquoi il est important que tous les professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins disposent des informations essentielles à cette prise en charge. Cette prise en charge repose sur des recommandations clairement établies.

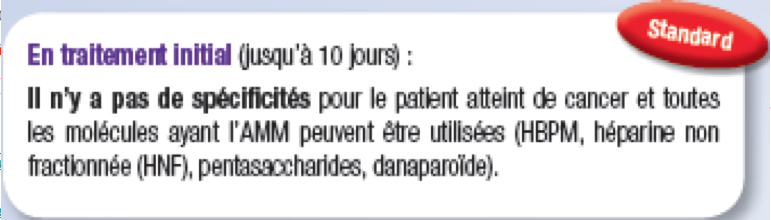

De nombreuses études montrent pourtant que ces recommandations ne sont pas suffisamment connues et appliquées.
Pour en savoir plus :
- Site de l’INCA
- Site Onco-Nouvelle-Aquitaine
P o i n t s d e v i g i l a n c e
Pour minimiser le risque d’erreurs médicamenteuses, l’ANSM attire l’attention des professionnels de santé et les invite à être vigilants devant toute prescription d’HBPM.
Plus particulièrement, il est recommandé aux prescripteurs :
- de rédiger leurs prescriptions en mentionnant la dénomination complète de la spécialité d’HBPM : nom de la spécialité avec la quantité totale en unité anti-Xa et le volume total en mL contenus dans la seringue, en fonction des indications préventives ou curatives,
- de préciser la posologie soit en mL/jour soit en UI/jour,
- de respecter les recommandations posologiques mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché (AMM)
Il est recommandé aux infirmiers(ères) et aux pharmaciens de se rapprocher du prescripteur en cas de prescription incomplète, ne mentionnant pas l’intégralité de la dénomination de la spécialité prescrite (incluant la quantité totale en unité anti-Xa et le volume total en mL contenus dans la seringue).
TECHNIQUE INJECTION DES HÉPARINES
L’administration par voie sous-cutanée peut entrainer la survenue d’hématomes au point d’injection surtout en cas de non-respect de la technique d’injection :
Attention : ne pas purger la seringue !
- Ajuster la dose seringue vers le bas !
- Injecter lentement
- Des nodules fermes cutanés liés à un phénomène inflammatoire peuvent apparaître
- Varier les sites d’injection
Ces réactions ne sont pas un motif d’arrêt de traitement.
Contrôle plaquettaire Non systématique sauf situations particulières
CONTEXTE CHIRURGICAL
- Réactions cutanées douloureuses au site d’injection
- Hémorragies
- Evolutivité de la maladie thrombotique
- En cas de thrombopénie inexpliquée, contacter le service spécialisé pour la conduite à tenir.
Surveillance du poids Absolument nécessaire. La posologie des HBPM doit être adaptée en fonction de la variation pondérale.
Surveillance de la fonction rénale: Les HBPM peuvent être utilisées avec précaution en cas d’insuffisance rénale sévère (clairance < 30 ml/min selon formule de Gault et Cockroft). Entre 20 et 30 ml/min de clairance, prendre un avis spécialisé. Une surveillance régulière est nécessaire. La fréquence dépend des traitements et des pathologies associées.
Surveillance de l’activité anti-Xa : Pas de surveillance systématique.
Surveillance des traitements associés :
- prévenir le patient des risques liés à l’automédication (AINS, aspirine à dose antalgique…).
- Pas d’injection en intramusculaire sans avis médical
Conclusion
Connaître ces recommandations, c’est comprendre pourquoi certains de vos patients cancéreux ont des anticoagulants au long cours. C’est donc mieux accompagner vos patients dans la compréhension et l’adhésion à leur traitement.
Sensibilisation à destination des patients :
La thrombose liée à un cancer n'est pas une thrombose comme les autres. Mieux la connaître, c'est mieux la repérer et mieux la traiter
Tout patient atteint de cancer a un risque majoré de développer, tout au long de son parcours, une thrombose veineuse (ou caillot obstruant une veine) qui nécessite une prise en soins spécifique.
Le groupe de travail régional Thrombose et cancer, coordonné par Onco-Nouvelle-Aquitaine, composé des URPS médecins, pharmaciens et infirmiers libéraux, de l’ARS, de l’OMEDIT, de pharmaciens d’établissements, d’universités de médecine, de médecins généralistes, vasculaires, d’associations de patients, et de patients partenaires a souhaité créer une vidéo d’information et de sensibilisation sur la maladie thrombo-embolique veineuse chez les patients atteints de cancer. Une vidéo pédagogique à destination des professionnels avait été créée par ce même groupe de travail.
Après avoir travaillé à l’écriture d’un scenario synthétique, ce groupe pluridisciplinaire a associé des patients volontaires pour intégrer la perspective « patient » à cette vidéo. Conjuguant expérience patient et expérience des professionnels de santé, cette vidéo vise à informer, à éviter les ruptures de parcours et à améliorer l’observance du traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse chez les patients atteints de cancer.
Réalisée par l’agence Prod/Uctive, cette courte vidéo animée explique par des messages simples ce qu’est la maladie thrombo-embolique veineuse en cas de pathologie cancéreuse, les signes d’alerte, le traitement adapté et sa surveillance
Cet outil de littératie en santé des patients atteints de cancer est destiné à une large diffusion auprès des patients, n’hésitez pas à relayer cette vidéo !

 onco-nouvelle-aquitaine.fr
onco-nouvelle-aquitaine.fr